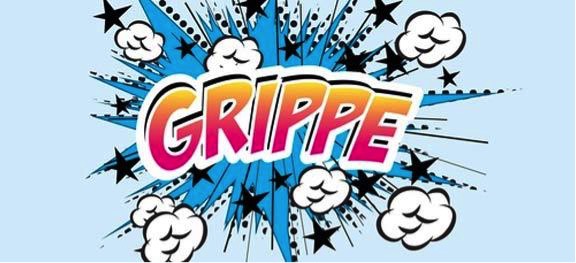
La grippe est une maladie virale qui s’accompagne de symptômes divers (fièvre, courbatures, maux de tête, écoulements nasaux, toux…). Les adeptes et convaincus du décodage savent que chacun de ces symptômes pourraient être abordés et décodés individuellement car le message du corps n’est pas le même en cas, par exemple, de toux ou de sinusite.
Mais cet article a pour objectif de proposer un décodage au sens large de la grippe et de ses pics épidémiques.
Premièrement, en s’appuyant sur une phrase usuellement utilisée et issue de ce que l’on pourrait nommer l’inconscient collectif on peut remarquer que le terme « prendre en grippe » décrit une situation conflictuelle avec quelque chose ou quelqu’un. Il s’y mêle conflit, désamour et colère.
Deuxièmement, plusieurs études ont maintenant démontré que le froid n’est pas responsable du fait que l’on tombe malade. D’ailleurs, vous avez sûrement tous déjà été grippés à d’autres périodes de l’année qu’en hiver. Si dans les pays tempéré l’épidémie de grippe survient principalement en hiver, les pays tropicaux subissent des épidémies fluctuantes durant l’année sans que cela puisse être relié à une saison particulière. Cette constatation amène une réflexion très intéressante sur le plan du conflit psychobiologique en toile de fond de cette maladie : Qu’est-ce que je vis, ou que nous vivons collectivement à une certaine période de l’année, pour que se développe une réparation collective de quelque chose « pris en grippe » ?
Le fait que la grippe revienne chaque année à la même période peut nous donner quelques pistes de compréhension.
Nous sommes en présence d’un conflit « en balance ». Le terme « en balance » fait référence au fait que le conflit s’active, se résout temporairement mais se réactive ultérieurement. Le conflit en balance engendrera, en phase de réparation, une maladie chronique.
Dans les faits, une maladie chronique est une maladie qui « revient dans le temps » entre des pauses plus ou moins longues sans symptômes.
Fait marquant dans nos pays tempérés, le pic épidémique se situe entre décembre et février de chaque année et cela depuis une date bien précise: la fin de la première Guerre Mondiale. Et plus précisément depuis la pandémie de grippe espagnole qui a suivi la guerre, durant l’hiver 1918-1919.
En effet, à l’issue de cette Grande Guerre, un conflit planétaire majeur ayant brisé quatre empires et tué près de 19 millions de personnes, une autre vague encore plus meurtrière s’est abattue sur le monde entier : la grippe espagnole qui causa 30 millions de morts.
Après un conflit mondial d’une « prise en grippe » planétaire entre pays, voici une maladie mondiale de « grippe » qui vient clore ce terrible épisode sanglant. Comment se reconstruire après tant de traumatismes ? Que de réparations individuelles et collectives il a fallu pour se sortir de ces 4 années d’horreur ! Et malheureusement nous pouvons constater que la solution biologique (la phase de maladie) est une phase très critique et sélective. Il faut des ressources psycho-physiologiques importantes pour accéder à la guérison.
Cette guerre mondiale a également ouvert à la notion de mondialisation. Les moyens de transports et de communication se sont mondialisés rendant les conflits et problématiques planétaires. Et depuis un siècle nous n’avons fait que progresser davantage dans cette globalisation. Notre conflit mondial n’est pas fondamentalement résolu, même si la Première Guerre puis la Seconde le sont politiquement. Et quoi de plus dangereux qu’un monde qui pourrait s’écrouler dans son ensemble ? Cette peur fondamentale accompagne l’humain depuis qu’il s’interroge sur l’existence. Et si nos propres conflits pouvaient nous mener à notre auto destruction ?
A cette crainte d’un conflit planétaire, vient s’ajouter l’impact transgénérationnel de cette réparation. Cette Première Guerre Mondiale n’est pas loin de nous, historiquement. Il existe encore, sur terre, des personnes qui l’ont vécue. Sachant que le traumatisme s’inscrit dans les gênes et se transmet aux générations futures, nous sommes tous les héritiers psychobiologiques de ce conflit dont l’onde de choc se fait encore ressentir.
Alors chaque année, comme une mémoire de ce qui doit être résolu de nos prises en grippe mondiales, nous sommes balayés par une vague d’épidémie grippale qui tente désespérément de réparer les répercussions de ce conflit sanglant. Et comme le symptôme lui-même a une fonction bien spécifique, il est intéressant de songer aux conséquences de l’état grippal. Que nous permet-il ? Il nous permet de rester chez soi. Donc de s’extraire durant un temps de la réalité du monde. Il nous permet de se tenir à distance des autres (« Non, ne venez pas trop près de moi, j’ai plein de microbes ! »). Il nous permet de baisser les armes, de se pacifier, de prendre du repos et du recul. Il nous permet de rester au chaud, de dormir. De fermer la porte aux choses extérieures pour ne s’occuper que de son intérieur et des ses manifestations.
Il nous permet d’être malade pour enfin prendre le temps de se soigner…
Et lorsque nous sommes soignés, ne nous retrouvons-nous pas, paradoxalement, à nouveau… « d’attaque » !?!
Venir en thérapie
Vous aimeriez faire une séance en Décodage psychobiologique pour traiter un symptôme ?
En savoir plus sur les possibilités de séances et les conditions :
Les thérapeutes
